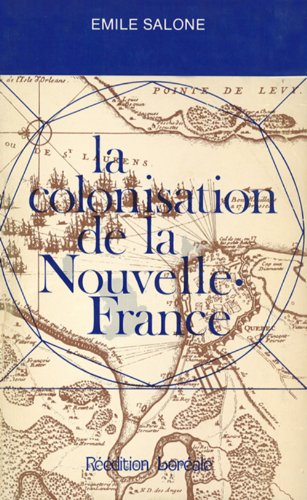 Paul Gosselin (30/6/2025)
Paul Gosselin (30/6/2025)
Récemment j'ai lu un vieux livre d'histoire, soit La colonisation de la Nouvelle-France par Émile Salone, publié initialement en 1905. Dans ce livre Salone nous offre une étude approfondie du développement de la colonie de la Nouvelle-France, en particulier de l'implication financière et militaire de la couronne de France.
L'époque de la fondation sous Samuel de Champlain est fascinante, mais le Québécois que je suis a été déçu de ne pas se faire offrir d'anecdotes sur l'adaptation que ces premiers colons français ont dû faire pour survivre l'hiver québécois avec son froid et sa neige abondante (neige qui peut commencer en novembre et durer jusqu'au début avril). Un tel froid est inconnu en France, sauf pour ceux qui habitent les Alpes. Mais les premiers explorateurs de la Nouvelle-France ne venaient pas des Alpes. Tout au plus Salone fait allusion aux difficultés de santé des Français lors de leurs premiers hivers dus à leur mauvaise alimentation qui aboutit au scorbut. En général les Québécois sont au courant que Champlain a consulté les Amérindiens à ce sujet qui lui conseillèrent de prendre de la tisane de cèdre afin de surmonter la carence en vitamine C. Les Amérindiens ont beaucoup appris à nos ancêtres : fabriquer les raquettes, les tabogannes, les canoës (seul moyen de transport pendant longtemps), faire du sirop d'érable, cultiver le maïs, la citrouille et le tabac.
Chose TRES curieuse, c'est à peine si Salone discute de la fin du régime français en Nouvelle-France. Il nous offre aucune description des stratégies des adversaires ou des diverses batailles qui ont influencé le sort des habitants français et mis fin à la Nouvelle-France. C'est à se demander si de telles questions (désagréables) auraient exposé l'incompétence des dirigeants français...
Assez rapidement Salone soulève une question importante : Comment se fait-il que cette colonie fût un échec si on la compare aux colonies anglaises un peu au sud (pourtant fondée avant elles) ? Un aspect de cet échec fut l'entêtement du régime français à imposer une structure sociale féodale en Amérique avec des seigneurs et des serfs/censitaires (en somme des esclaves liés à leur terre). Pour le paysan français cherchant à améliorer son sort, la situation en Nouvelle-France offrait peu d'attrait. Pourquoi quitter son pays pour se retrouver sous le même carcan (social, politique et économique) ? Comme le note Salone (p. 341), en désespoir de cause, on a même pensé augmenter l'immigration en transportant des criminels en Nouvelle-France... Ce fut aussi un échec... Cette situation offre un lien avec un autre aspect de cette échec c'est-à-dire le peu de liberté accordé aux habitants, et ce régime qui insistait à gérer[1] toutes sortes d'aspects de leurs vies. En France on a toujours été épris d'un modèle de pouvoir politique TRES centralisateur[2]. Cela me fait penser que si les habitants de la Nouvelle-France après la réédition en 1759 n'ont pas fait une guérilla aux conquérants anglais, c'est possiblement dû au fait qu'ils ont fait un calcul que la vie sous les Anglais serait plus libre que sous le régime français... Autre morceau du puzzle est le fait que les associations de commerçants gérant l'immigration avaient des intérêts commerciaux (le profit immédiat) en contradiction avec les dépenses exigées pour la promotion de l'immigration.
Mais toutes ces considérations sont finalement secondaires lorsqu'on ose comparer l'immigration un peu au sud, dans les colonies anglaises. Dans mes lectures, j'ai vu des textes affirmant que pendant la période française (1608-1759) il eut 40,000 Français qui ont immigré en Nouvelle-France. Mais pendant la MÊME période, plus d'un million ont immigré en Nouvelle-Angleterre!!! À peu de choses près, Salone est du même avis, mais propose un chiffre légèrement supérieur pour l'immigration française (1970/1905 : 452)
Soixante-dix mille Français au Canada ! Après cent cinquante ans de domination effective, c'est, pour la nation qui fut au dix-septième et au dix-huitième siècle souvent la plus puissante et toujours la plus civilisée et la plus nombreuse de l'Europe, un résultat dérisoire. Et dans le même espace de temps, de l'Acadie à la Floride, les Anglais établissent plus d'un million d'hommes.
Si Salone propose le chiffre de Soixante-dix mille Français au Canada, on peut se demander s'il ne triche pas un tout petit peu en incluant les naissances de Français au Canada pendant le régime français. Salone ne justifie pas ce chiffre. Peu importe, le résultat final est le même, faute de ressources (démographiques et matériels) la Nouvelle-France ne sut résister aux attaques des Anglais et la colonie fut perdue.
Salone est tout à fait conscient que la Nouvelle-France aurait pu avoir un attrait pour les Huguenots (protestants français persécutés en France[3]) comme terre d'asile. Il l'avoue assez ouvertement en observant (1970/1905 : 44-45)
La décision de Richelieu a été condamnée par la généralité des historiens français, et même par quelques historiens canadiens-français comme François Garneau et l'abbé Casgrain. Ils invoquent l'exemple des Treize colonies qui doivent leur naissance et leur prodigieux accroissement à l'asile qu'elles offrirent toujours aux dissidents politiques et religieux de la métropole. Au dix-septième siècle la situation n'est-elle pas la même des deux côtés de la Manche ? Pourquoi avoir fermé l'Amérique française à ceux-là mime des Français qui avaient le plus d'intérêt à chercher outre-mer une patrie nouvelle ? La question posee de la sorte, il est impossible de ne point se joindre à ceux qui blâment le plus fortement. En vérité, si la puissante émigration Huguenote qui, bien avant la Révocation, commence à se répandre à travers le monde, avait pu être dirigée vers le Saint Laurent ou le Mississipi, nul doute que le patrimoine de notre race et de notre langue n'en eût été, pour l'avenir, singulièrement agrandi. Mais il resterait à savoir si protestants et catholiques étaient capables de vivre, côte à côte, en paix, si l'on n'aurait pas été obligé de les séparer, de les cantonner, si surtout nos calvinistes auraient pu ne pas succomber à certaines tentations qu'eût multipliées le voisinage immédiat de leurs coreligionnaires de la Nouvelle-Belgique et de la Nouvelle-Angleterre.
Mais bon, l'obstacle principal et fatal à la liberté religieuse en France a été le dogme catholique du Cujus regio, ejus religio, dogme qui a régné pendant plus d'un millénaire en Europe, et dont la logique aboutie à l'équation : un roi/territoire = une religion/Église[4]. Ce dogme excluait irrémédiablement la liberté religieuse sur le territoire français. Salone fait allusion à cette intolérance religieuse du catholicisme français en parlant (p. 103) d'une véritable théocratie en Nouvelle-France. Il est vrai que pendant un bref moment au début, des Huguenots étaient présents en Nouvelle-France et les compagnies françaises à qui ont avait accordé des monopoles de commerce en Nouvelle-France étaient gérés par des Huguenots (les Cent Associés et la Compagnie des Indes orientales). Ce détail offre une prétexte toute faite à Salone pour expliquer le contraste entre l'immigration en Nouvelle-France et les colonies anglaises. Tout est de la faute des Huguenots ! Au sujet de la responsabilité de l'échec de l'immigration sous les Huguenots Salone affirme (1970/1905 : 46)
Ils ont fait pis que de mériter, à un moment donné, d'être chassés du Canada. Ils l'ont eu entre les mains, et ils n'en ont rien fait. De 1603 à 1627 ils ont été les maitres à l'habitation de Québec, et notamment, jusqu'à l'arrivée des Jésuites, en 1611, ils n'ont eu à subir dans l'exercice de leur prépondérance aucun autre contrôle que celui de l'impartial, du tolérant Champlain. Voici vingt-quatre ans, voici huit ans, pour le moins, où ils ont eu toutes les facilités pour s'implanter solidement dans le pays.
Mais cette affirmation de Salone est hypocrite, car il néglige sciemment un détail critique, c'est-à-dire que la liberté de pratique religieuse pour les Huguenots/protestants n'a JAMAIS été admise en Nouvelle-France. Si initialement on a toléré la présence physique des Huguenots sur le territoire, c'est simplement qu'on avait besoin de leur fric pour le développement de la colonie. Le roi de France ne voulait pas y mettre le sien. C'est la seule raison qui a motivé leur présence. Ainsi, si au début de la colonie la présence physique des Huguenots était tolérée, ils n'ont jamais joui de liberté de pratique religieuse. Sous le régime français, aucune église Protestante n'a été construite sur ce territoire et les Huguenots n'ont jamais pu pratiquer ouvertement leur religion. Comme le note Salone (p. 65) les Jésuites arrivent vers 1611 et se sont immédiatement mis à dénicher et faire abjurer les Huguenots en les forçant à devenir catholiques.
Ainsi l'accusation de Salone touchant la négligence des Huguenots tombe d'elle-même, car il est manifeste que pour les Huguenots l'immigration en Nouvelle-France n'était rien d'autre qu'un piège et que pour trouver un asile où la pratique ouverte de leur religion était possible, les Huguenots envisageant l'exil devaient nécessairement exclure TOUT territoire sous le pouvoir du roi de France. Si les Huguenots avaient pu jouir de liberté religieuse en Nouvelle-France, ils seraient venus massivement pour en profiter, mais la situation en Nouvelle-France les força de trouver refuge dans des pays tels que l'Allemagne, l'Angleterre, l'Afrique du Sud et les États-Unis, là où leur identité française serait inévitablement érodée. Une seule exception: la Suisse francophone.
Le petit nombre de Huguenots établis en Nouvelle-France furent donc mis devant un choix funeste, soit d'abjurer leur foi pour devenir catholiques ou fuir de manière clandestine vers les colonies britanniques. Un peu par lapsus, Salone admet la réalité de ce piège (1970/1905 : 44)
Les édits de 1627 et de 1628 mettent fin à ce régime vraiment libéral. Certes on ne peut pas dire qu'à partir de cette époque les protestants soient absolument exclus du Canada. À la condition expresse de renoncer à toute manifestation extérieure de leur culte, ils gardent le droit d'y commercer (2). Mais ils ne peuvent pas s'y établir à demeure (3). Ils n'y doivent même pas hiverner (4). Il n'y aura pas de colons Huguenots au Canada.
Cette intolérance française pour les protestants francophones eu des conséquences dramatiques pour l'avenir de la Nouvelle-France (et faisant face à des persécutions féroces en France, les Huguenots auraient bien voulu immigrer en Nouvelle-France si la liberté de pratique religieuse leur avait été garantie). Dans la Nouvelle-Angleterre (colonies britanniques qui deviendront les États-Unis), la liberté de pratique religieuse a été vite établie.
Ceci implique que si les autorités françaises avaient accepté la liberté de pratique religieuse pour les protestants en Nouvelle-France, alors sans aucun doute il y aurait eu une immigration massive de Huguenots en Nouvelle-France. Et si l'immigration française avait été équivalente à l'immigration en Nouvelle-Angleterre, il se pourrait qu'aujourd'hui la moitié de l'Amérique soit francophone (et protestante)... Mais les autorités françaises étaient trop bornées pour accepter une telle chose. Et à la fin (jugement de Dieu ?) ils ont tout perdu de leurs possessions en Amérique, et les francophones en Amérique se retrouvent dans une situation de marginalité permanente, entourés de 350 millions d'anglophones... S'il faut reconnaître qu'après la conquête britannique l'église catholique a défendu le fait français au Québec, il faut aussi reconnaître que l'église catholique est le premier responsable de la marginalité du fait francophone en Amérique[5]...
d'Aubigné, Agrippa (1616) Les Tragiques. (PDF)
Blaquière, Jacques (2010) Quelques ancêtres québécois de la religion réformée de Jean Calvin (1659-1681). p.10 (Société d'histoire du protestantisme franco-québécois - mars, Bulletin 10)
Brutus, Stephanus Junius (1579) Revendications contre les tyrans. [De la puissance légitime du prince sur le peuple et du peuple sur le prince] (PDF 5Mb) texte polémique Huguenot rédigé sous pseudonyme.
Cartier, Jacques (1545) Bref Recit et Succincte Narration de la Navigation Faite en MDXXXV et MDXXXVI par le Capitaine Jacques Cartier aux Îles de Canada et Autres. (PDF)
Delattre. S. (1924) Les Prophètes cévenols et la guerre des Camisards de 1701 à 1704. (VoxDei)
Gendron, Alain (2002) Les protestants francophones au Québec: une présence qui ne date pas d'hier. (Samizdat - 2/3/2002)
Lougheed, Richard & Jean-Louis Lalonde (2019) Les abjurations franco-protestantes au Québec pp. 5-7 (Société d'histoire du protestantisme franco-québécois - Bulletin 64 - juin)
Misson, Maximilien (1707) Le Théâtre sacré des Cévennes ou récit de diverses merveilles opérées dans cette partie de la Province du Languedoc, à Londres : chez Robert Roger, 1707 (part. 1 [archive]) ; réédition critique présentée par Jean-Paul Chabrol, à Nîmes : Éditions Alcide, 2011, 248 p.
Perron, Guy (2014) Les abjurations à Québec de 1662 à 1757. (Blogue de Guy Perron - 9/9/2014)
Salone, Émile (1970/1905) La colonisation de la Nouvelle-France : étude sur les origines de la nation canadienne française. Boréal Express - Trois-Rivières 505 p.
[1] - Micro-manage comme disent les américains.
[2] - Et la Révolution Française n'a fait qu'amplifier cette tendance (en excluant la noblesse).
[3] - Les Huguenots furent persécutés en France pendant presque 250 ans, persécutions diverses dont l'interdiction d'immigration, le massacre de la Saint-Barthélemy (1572) et les dragonnades sont les plus connus. Les hommes protestants pouvaient être envoyé aux galères (=esclaves à vie) et les femmes, à de longues années de prison, comme le sera Marie Durand, emprisonnée au 18e siècle à la Tour de Constance pendant 38 ans. Dès 1680, les Huguenots sont la cible des dragonnades, devant recevoir dans leur demeure les soldats du roi, qui pouvait leur prendre tout ce qui leur tombait sous les yeux, même la fille du proprio... Imagine héberger dans sa propre maison des ennemis qui vous insultent et vous volent impunément...
[4] - Cette tradition millénaire prit racine avec l'Édit de Milan (313 apr. J-C) émis par l'empereur Constantin et fut exprimée de manière formelle en 1555 à la paix d'Augsbourg.
[5] - Et depuis 3 générations cette marginalité a été amplifée autant par l'avortement et une natalité dérisoire que par une immigration qui n'a aucun intérêt pour la culture francophone des Québécois. Un article du journaliste québécois Samuel Lamarche digère péniblement les répercussions de cette réalité.
Un sentiment de dépossession. (Libre Média – 23/6/2025)